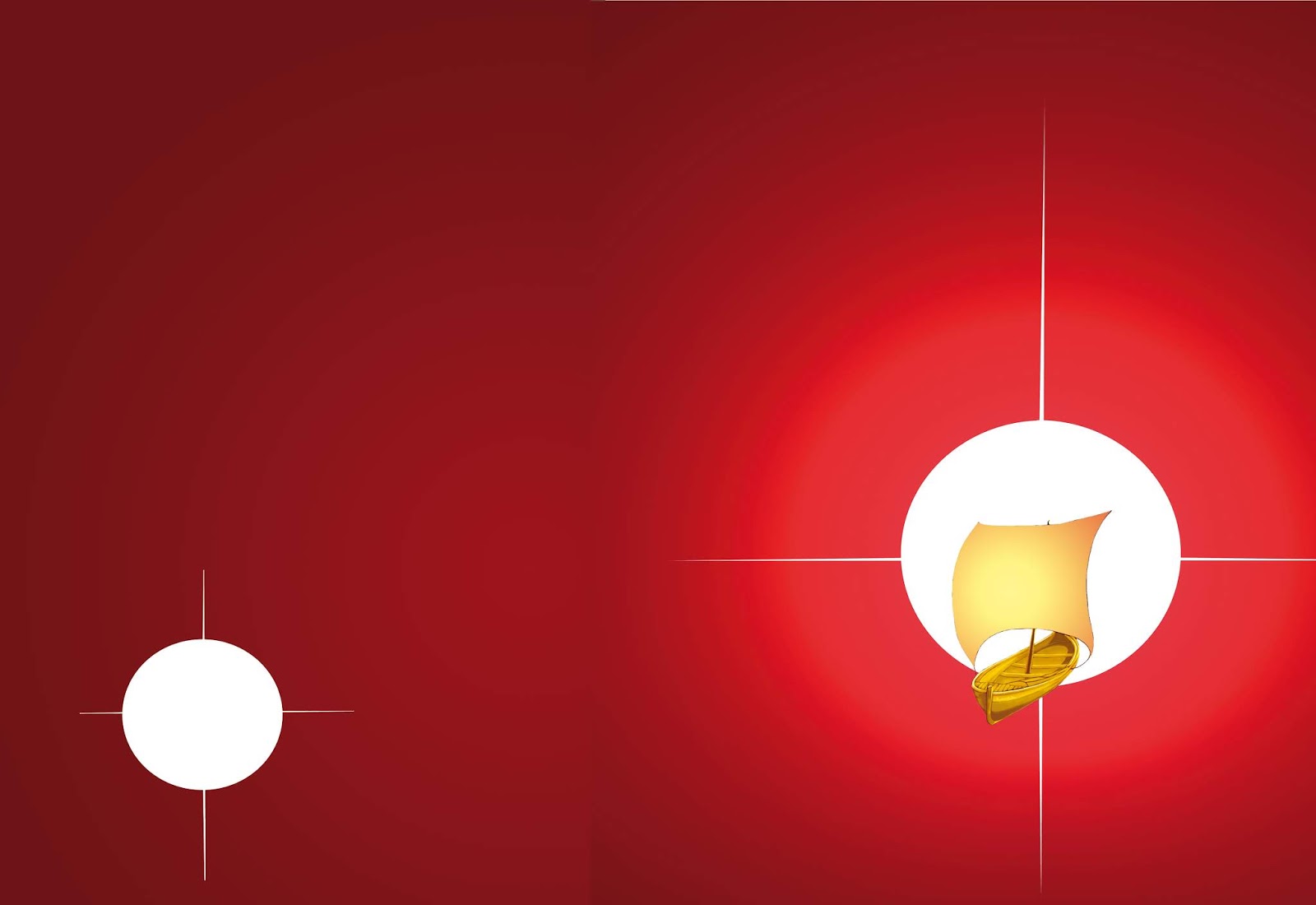Parce qu’il était casanier et que sa femme voulait qu’ils sortent un peu, il demanda au Génie :
– Je fais le souhait de pouvoir passer tout mon temps à la maison avec des séries en streaming et des jeux vidéo à gogo !
Ce soir-là, quand il la rejoignit au lit, il remarqua qu’elle faisait une drôle de tête :
– Tu sais, tu pouvais juste me dire que tu n’avais pas envie, t’étais pas obligé de gâcher aussi la vie des voisins.
The Tale of Nokdu
 Il vit sur une île isolée, avec son père et son frère, quand un groupe d’assassines tente de les zigouiller. Son enquête le conduit dans un village de veuves, qui abrite le groupe d’assassines, et il se déguise donc en veuve pour en apprendre plus. Il fait la rencontre d’Elle dont la famille a été tuée et qui a été recueillie par la maison des courtisanes qui travaille en symbiose avec le village des veuves.
Il vit sur une île isolée, avec son père et son frère, quand un groupe d’assassines tente de les zigouiller. Son enquête le conduit dans un village de veuves, qui abrite le groupe d’assassines, et il se déguise donc en veuve pour en apprendre plus. Il fait la rencontre d’Elle dont la famille a été tuée et qui a été recueillie par la maison des courtisanes qui travaille en symbiose avec le village des veuves.
Pour qu’Elle ne devienne pas courtisane, Il paie et l’adopte en tant que mère. Ils se disputent et s’aiment.
Puis ils quittent le village pour mener chacun leur quête (lui son enquête, elle sa vengeance), il devient garde royal, elle devient servante…
Le rythme est assez curieux : on est toujours sur du 16 grosses heures, mais par épisodes de 30 minutes.
L’histoire évolue beaucoup : la vie au village des veuves, lui cachée en tant que femme, la vie à la capitale, etc.
J’ai aimé la simplicité avec laquelle Lui devient une femme, sans se prendre la tête, sans se sentir menacé dans sa virilité et en restant le grand guerrier.
Le truc « en plus » de cette histoire, c’est le lien entre les personnages : au fil des épisodes, une famille disparate se compose, adoptant sur son passage tous ceux qui sont seuls et qui vont aider.
Et des méchants rongés par leurs folies et faiblesses.
Ici, les gentils ne sont pas les gentils parce qu’ils sont too much, mais juste parce qu’ils sont sains et ont compris le vrai sens de la vie.
Mâle, mon héros
Je suis née dans les années 1970. J’ai été amoureuse d’Indiana Jones et d’Han Solo. (De Raistlin, également, et de Sherlock Holmes, mais c’est une autre histoire 😉 ) Je n’ai pas été horrifiée que Jones capture une petite poulette de son fouet. Je voudrais bien vous raconter que, très tôt, j’ai remis en cause le modèle du couple monogame hétérocentré, mais ça n’est pas du tout le cas. C’était le Modèle et même si, confusément, je sentais bien qu’il ne me correspondait pas, à moi, personnellement, ça venait forcément de moi. J’ai aimé les bad boys. En fiction, parce que, irl, faut pas déconner non plus.
Ma première grosse claque narrative, je pense que c’est Buffy contre les vampires. Il y a eu un avant et un après.
Et puis un jour, après des années à se farcir la télévision classique et ses programmations déplorables (épisodes dans le désordre, diffusion tardive…), la bonne qualité des connexions internet a changé tout ça.
Et puis il y a eu Netflix : on peut pester contre les grandes compagnies, mais il y a eu là aussi un avant et un après. J’ai probablement souscrit à l’abonnement pour The Good Place à l’été 2018. Tout de suite, je suis tombée sur Love in the Moonlight et A Korean Odyssey.
Si j’ai trouvé le premier charmant (je n’ai jamais caché mon attrait pour les comédies romantiques), le deuxième a été une nouvelle claque : j’ai pris davantage conscience de mon inculture (non, je ne savais rien de la Pérégrination vers l’Ouest et, oui, j’ignorais que le petit garçon avec une queue de singe dans Dragon Ball était le roi-singe), mais j’ai aussi été littéralement séduite par cette fantasy mythologique et le questionnement sur l’amour. Lui est un dieu qui veut la manger, Elle, mais en est empêché seulement par un objet magique qui l’oblige à tomber amoureux. Que vaut cet amour forcé ?
70 dramas plus tard…
Tandis que, vendredi soir, une académie de vieux mâles blancs sacrait l’un des siens, indifférente à la saine indignation que cela allait déclencher à travers le monde, je binde-watchais Her Private Life. Le genre de comédies romantiques sur lesquelles je n’aurais pas fait un billet. Parce que c’est mignon, mais ça me fait plaisir à moi, je n’ai rien à en dire particulièrement.
Sur les réseaux sociaux, on parlait de ces prédateurs dont le visage monstrueux ne nous saute aux yeux que désormais, après #MeToo, et, de l’autre, j’avançais dans une série tendre où le héros… hé bien… est juste… un homme ? Pas un prédateur, un homme.
Pause
Je n’ai remis en question le Modèle que très récemment.
#MeToo a été une révélation pour moi car, comme la majorité d’entre nous, j’avais considéré normaux des comportements qui ne l’étaient carrément pas. Et, comme pas mal d’entre nous, j’ai lu la mauvaise foi au fil des commentaires imbéciles : comment peut-on séduire si on n’a plus le droit de contraindre l’autre ?
Les baisers volés ? J’avais toujours eu en tête les paroles d’Alain Souchon.
Et puis, y’a pas longtemps, parce qu’un garçon me plaisait vraiment beaucoup, des (plusieurs) copines (bien intentionnées) m’ont demandé pourquoi je ne lui volais pas un baiser, justement. Pourquoi je ne lui offrais pas un verre ou deux, m’habillant « légèrement »…
Pourquoi ?
Parce que, du coup, pour établir la confiance avec ledit gars, je le sentais super moyen.
« J’ai envie de t’embrasser ; est-ce que c’est réciproque ? Et, même si c’est réciproque, mais que tu ne peux pas, pour des raisons qui t’appartiennent, ben, ça s’arrête là. »
70 dramas plus tard…
Je ne parle pas de société. Je ne connais pas (vraiment) la société coréenne et je me doute qu’elle n’est pas forcément tellement plus tendre que la nôtre envers les femmes.
Je parle de fictions. De narrations.
Parce que nos modèles commencent avec les fictions.
Je ne sais pas combien j’ai pu regarder de films et de séries depuis ma naissance, lire de livres… mais je fais le pari que la majorité était française ou américaine.
70 dramas coréens plus tard…
Alors, oui, Lui est très riche. Le syndrome de Cendrillon ? Je ne trouve pas. En général, Elle est méritante, intelligente, cultivée malgré le coût des études.
Lui pleure, facilement, souvent. Il est beau et érotisé, mais il n’est pas un objet sexuel.
Il ne l’embrasse pas de force. Il lui demande sa permission, il attend.
Même s’il a très très envie d’Elle car ils sont très très amoureux, il s’assure qu’Elle sait bien ce qu’ils vont faire, qu’Elle est pleinement d’accord.
Comment peut-on séduire si on n’a plus le droit de contraindre l’autre ?
Alors j’ai un secret pour vous : la question est totalement autre.
Comment se fait-il que les modèles occidentaux ne soient plus séduisants du tout après quelques dramas ?

A l’est, Her Private Life.
C’est une « simple » comédie romantique.
Elle travaille dans une galerie d’art, Il devient son chef et ils tombent amoureux et… Le genre de comédie que j’apprécie, mais dont je me doute que ça n’intéresse pas grand monde ici 😉
Sauf que le héros est l’anti-prédateur et que ça fonctionne super bien.
Elle a un secret : sur son temps libre, elle est la fan la plus investie d’une idole qu’elle suit partout, prend en photo… ce qu’elle ne veut surtout pas qu’on découvre, de crainte de casser son image « lisse » de conservatrice.
Lui, sur un malentendu, pense que son secret est qu’elle est lesbienne (en couple avec sa meilleure amie) et il va donc protéger cette vie privée qu’il pense menacée.
Bien sûr, ce malentendu est un prétexte pour démarrer leur histoire de façon humoristique, mais, en fait, au delà du malentendu cocasse, le traitement en est très tendre : pas un instant, tant qu’il la croit lesbienne, il ne la voit en tant que femme et il veut s’assurer de protéger son employée comme minorité menacée par une société conservatrice. Et, quand il découvre qu’elle est hétéro, ils ne se sautent pas dessus.
– Ben, quoi, c’est normal, non ?
– Oui, c’est normal. Mais cette normalité est agréable. Cet homme est complètement un anti-prédateur et c’est juste incroyablement romantique.
– Ouais, ben, moi, je trouve ça juste normal.
– Tu as raison. Mais j’aime les comédies romantiques tendres bourrées de consentements.
A l’ouest, Cinquante Nuances de Grey.
Bon, oui, je sais, je n’ai ni lu le livre ni lu le film. Sorry.
Je suis pleine de préjugés.
De préjugés qui me disent que ça ne parle pas de respect et de consentement.
La Matrice
Quand on a ouvert les yeux, on ne peut plus revenir en arrière.
Je suis de celles qui, longtemps, n’ont pas vu ce qui clochait. Parce qu’il y avait un Modèle et c’était comme ça. Et même s’il n’était pas le mien, c’était celui qui était. Je devais me protéger, moi, perso, mais je n’avais aucune idée du Système. Aucune idée que les fictions peuvent le nourrir ou le rendre obsolète.
Aucune idée que, un jour, je ne pourrais plus du tout mettre les mêmes idées derrière « comédie romantique ».
Est-ce tout simplement pour cela que la pop-culture coréenne séduit autant les jeunes femmes ? En tout cas, si certains vieux mâles occidentaux ne voient pas comment on peut draguer, elles, elles le visualisent très très bien !
Aujourd’hui, je ne renie pas Indiana Jones, je l’ai aimé. Mais j’aurais probablement un petit sourire gêné face à lui et je déclinerais poliment son invitation à dîner.
Et, ça, je ne l’avais vraiment pas vu venir.
Ceux qui n’évoluent pas disparaissent. La masculinité va changer. Elle sera respectueuse et tendre et ceux qui rateront le virage se mangeront un mur.
Rendez-vous dans quelques années 🙂
Pour ma part, je ne sais vraiment pas comment j’écrirai l’amour demain, mais je sais que plus rien ne sera jamais comment avant…
/musique de fin
Histoire d’ogre et de pont
10.000 signes – Temps de lecture : 9 minutes
Il était une fois. Oui, cette fois précise là. Évidemment, personne ne sait jamais laquelle, mais c’est ainsi que commencent les histoires et, partant, celle ci. Il était donc une fois un ogre qui vivait sous un pont. Ce n’était pas parfaitement régulier puisque ce sont les trolls qui vivent sous les ponts mais, d’une part, cet ogre l’ignorait et, d’autre part, il est fort probable qu’il ait eu l’un d’entre eux pour ancêtre. Pour tout dire, il était très laid. Vraiment très laid. Avec des sourcils proéminents, d’immenses dents plantées de guingois et de longs poils touffus plein les oreilles. Sans doute louchait il aussi, mais l’histoire n’en dit rien.
Donc, cet ogre vivait sous un pont. Un pont passablement bien situé, sur une large route heureusement très fréquentée, car les jeunes gens des proches villages, y ayant perdu quelques uns des leurs, avaient renoncé à y passer, mais bon… il y en avait toujours un pour jouer au plus malin. Notamment parce que la jeune Aloyse se moquait copieusement de leur poltronnerie. N’y passait elle pas quasi quotidiennement pour aller vendre des œufs, des fromages, des paniers ?
De fait, c’était non seulement le plus court chemin entre le village et sa ferme mais, aussi, le moins approprié aux soupirants trop entreprenants.
Ah, direz-vous, mais n’y avait il pas un ogre sous ce pont, et qui dévorait les imprudents de passage ? Eh bien, oui. Seulement, la nourriture, ce n’est pas tout dans la vie. Et Aloyse, si elle était fort bavarde, comme nombre de jeunes filles, était également sinon fort savante, du moins fort réfléchie. On en a du temps lorsque l’on garde des chèvres, ou que l’on tresse des paniers et toutes ces choses si ennuyeuses qui occupent les mains mais non l’esprit. Ce qui fait sans doute toute la supériorité de la gent féminine au bout de siècles passés à laver la vaisselle.
C’est dire qu’elle consacrait beaucoup de ses pensées… à penser justement, tout à fait comme les ogres qui s’ennuient. Et comme toutes ces pensées eussent été vaines si elle n’en avait usé, elle les faisait largement partager à son petit frère qui trottinait à ses côtés, l’aidant tantôt à porter quelques bricoles, ramassant tantôt un joli caillou, réclamant tantôt un nouveau conte ou répétant les horribles fables qui couraient sur ce pont. Sa grande sœur ne faisait qu’en rire. D’abord les ogres n’existent pas. Et puis ils ne mangent que les enfants méchants – et, toi, tu es un petit garçon vraiment gentil n’est-ce pas ? – ou bien les adolescents boutonneux qui bourdonnent comme des mouches. Ça a bon goût, dis, un adolescent boutonneux ? Bien sûr que non, mais les jeunes gens bien, eux, ne traînent pas sur les chemins… Ils étudient à l’école, comptent en contemplant les étoiles, et lisent en écrivant de la poésie dans les marges… quand ils ont le temps.
Bref, toutes ces conversations avaient toujours un petit tour cultivé et charmant que l’ogre prisait fort. Il se faisait donc un devoir de semer auprès du pont de ces petits cailloux brillants qui comblaient de joie le garçonnet.
Pourquoi publies-tu des livres ?
Commençons, comme il se doit, par un petit résumé des épisodes précédents :
Dans les milieux du livre (bande dessinée incluse), on apprend que le marché est en surproduction et que les auteurices sont les grand·es perdant·es.
Récemment, quelqu’un·e me faisait remarquer que, plus jeune, il y avait peu de livres de fantasy et qu’elle pouvait suivre plus ou moins la production, mais que, désormais, quand il flânait dans une librairie, elle ne savait que choisir entre les centaines de versions d’une même quête, du même assassin sombre qui…, du…
Je pose toute suite un bémol : liberté, choix, c’est cool. Si l’on a vraiment le choix, i.e. accès de la même façon à tout. Et on sait bien que ça n’est pas le cas : nos choix vont être contraints par les campagnes de com’ et le placement en librairies.
Je suis écrivaine. C’est une donnée comme ma taille, mon poids, la couleur de mes cheveux.
J’ai mis longtemps à réaliser pourquoi ça me définissait, mais ça me modèle énormément : que j’écrive un billet de blog ou un statut sur un réseau social, je me relis mille fois en me demandant si ce sont les bons mots. Que je raconte la moindre histoire à un pote croisé dans la rue et je me demande s’il peut comprendre, si j’ai situé les personnages, si l’anecdote est assez intéressante. Je décortique les films, les séries, les gens dans la rue (hein ? what ???).
Bref, j’aime écrire, j’aime la narration. Je dévore les histoires car c’est ce que je préfère (hormis le chocolat, disons).
Nous voici au cœur de la question. J’ai bien conscience que je suis candide, que je dois avoir oublié des milliers de paramètres, mais… pourquoi mes ami·es, mes collègues écrivain·es continuent-il/elles ?
Je ne parle pas d’écrire, hein, mais de proposer leurs écrits aux éditeurs.
Il me semble que se faire éditer a du sens si, tout à la fois (ou au moins l’un des deux), on en retire un revenu et on se fait connaître (on écrit pour raconter une histoire aux autres).
Je mets volontairement de côté les faux écrivains, vrais enfoirés, qui sont publiés alors qu’ils n’intéressent personne parce qu’ils font partie d’un milieu qui s’auto-entretient.
La/le vrai·e écrivain·e. Pas non plus celle qui est si connue qu’elle se retrouve dans les meilleures ventes.
Non, celui qui a une bonne histoire, un style assuré, mais dont le roman restera seulement quelques jours en rayon parce que la surproduction presse derrière.
Parce que, sur un coup de chance, le livre pourrait se dégager du lot ?
Qui mise sur la chance ?
Parce qu’il n’y a pas d’autres solutions ?
Je suis très embarrassée parce que je ne comprends pas.
Sans les auteurices, graphistes… il n’y a pas de livres, non ?
Sans artiste, au mieux, l’éditeur ne peut qu’embaucher des pigistes pour une commande. Soit ce produit satisfait le lectorat et, tant pis, c’est la loi du marché. Soit le lectorat n’est pas dupe et il retournera vers les artistes, où qu’ils se trouvent… non ?
Alors, oui, cela demande beaucoup de courage, de solidarité.
Parce que, pour que ça fonctionne, il faudra de la patience (en années, pas en mois), il faudra des visionnaires (parce qu’il n’est pas toujours aisé d’inventer de nouvelles solutions), il faudra de l’entraide, des écrivain·es un peu connu·es qui s’affichent aux côtés des talents émergents.
Mais n’est-ce pas plus réconfortant de tenter une aventure qui peut avoir une issue favorable plutôt que de suivre un chemin tout tracé qui ne conduit qu’à l’échec ?
— Ouais, mais, là, en gros, tu condamnes des tonnes de métiers, quoi : imprimeurs, libraires, éditeurs… ?
— Alors pas forcément et, si oui, quelle importance ?
Tous les métiers évoluent, c’est comme ça. Maintenir des emplois, c’est veiller à construire une société où chacun·e puisse évoluer professionnellement, pas entretenir des métiers qui ne servent à rien.
Et où est-il écrit que les artistes devraient se sacrifier pour entretenir une chaîne du livre qui ne fonctionne pas ? Parce que je n’ai lu nulle part qu’elle fonctionnait.
J’ai lu des articles sur des auteurices qui ne s’en sortaient pas, mais également sur des éditeurs et des libraires.
En 2000, j’avais une petite maison d’édition, Oxalis éditions. Parce que j’adore fabriquer des livres. Sérieux, c’est vraiment agréable. J’ai découvert la chaîne du livre, les retours des libraires…
Je me suis posée et je me suis dit : « Putain, Cenli, ce n’est juste pas viable du tout, ça n’a pas de sens ! »
C’était il y a 20 ans. Depuis, je n’ai rien vu qui laisse penser que cette économie soit devenue sensée, hormis pour quelques grosses boîtes élues. Je vois surtout des éditeurs qui ferment.
Quand on a lancé les Vagabonds du Rêve, on a volontairement choisi la forme associative : aucun employé, aucun local, aucune charge fixe. Les artistes sont rémunéré·es en droit d’auteur, donc sur les ventes. Et la littérature n’est vendue que sur la boutique en ligne. Le jeu de rôle est distribué en magasins spécialisés parce que, dans le jeu de rôle, ce sont des ventes fermes.
— OK, ça, c’est en tant qu’éditrice, mais en tant qu’écrivaine ?
— Ben, déjà, la nature m’a fait partir avec un gros handicap : je suis nouvelliste.
Forcément (on doit être nombreux dans ce cas), je suis passée par plein d’étapes, genre « et si j’écrivais un roman ? » ou « quelqu’un va bien finir par remarquer mes nouvelles ! »
Écrire un roman ? Pas forcément une œuvre à laquelle je tienne, non, un produit simple, formaté, un exercice relativement facile quand on peut aligner plus de 5.000 signes/heure. En quatre mois, tu as un premier jet. Mettons que tu t’accordes le même temps de relecture. En moins d’un an… et puis ? Tu ajoutes un titre de plus dans une surproduction qui te noie toi-même en tant que lectrice ? Ça te fait vraiment vibrer ?
En tant qu’écrivaine, pour l’instant, je pense qu’il n’y a rien d’attirant dans la chaîne du livre. Je vais continuer à poser des questions candides, continuer à suivre l’actualité, continuer à observer.
— Mais tu n’écris plus ? Tu ne vas plus proposer d’histoires aux gens ?
— Ben, si, il y a ce blog.
— Personne ne le lit !
— Et ? Quelle différence avec un livre posé quelques jours en librairie et que personne ne verra ?
PS : Je ne lis l’article qu’aujourd’hui, mais il date du 6. Samantha Bailly répond à ActuaLitté.
L’idée est de faire évoluer le milieu. Je pose ça là car c’est intéressant et je soutiens clairement la démarche en lui souhaitant le meilleur. Juste que, entre l’intervention de l’État pour remettre toute la chaîne du livre d’aplomb et la recherche de voies alternatives, perso, je me reconnais plus dans la voie d’à côté. Mais c’est sans doute que je suis accro au changement 😉
My Holo Love (2020)
 Une fois n’est pas coutume, je peux m’imaginer que je suis l’actualité puisque My Holo Love est sortie vendredi dernier sur Netflix, Netflix qui la présente comme une « mini-série ».
Une fois n’est pas coutume, je peux m’imaginer que je suis l’actualité puisque My Holo Love est sortie vendredi dernier sur Netflix, Netflix qui la présente comme une « mini-série ».
Alors je ne veux pas être trop psychorigide (si, si, je le suis et j’assume !), mais en quoi 12 épisodes au lieu des 16 en moyenne peut justifier le qualificatif de « mini » ?
Lui est un informaticien de génie, hacker, qui souffre d’un handicap qui l’empêche de se lier aux autres (enfant, il ne parlait pas — il est persuadé que sa mère s’est suicidée car il était un fardeau). Son meilleur ami est donc Holo, une IA-hologramme qu’il développe et qu’il va bientôt commercialiser.
Elle souffre de prosopagnosie. Pour ne pas être moquée, elle cache sa maladie, mais, du coup, elle passe pour une égoïste pimbêche.
« Par hasard », elle se retrouve bêta-testeuse d’Holo, implantée dans des lunettes, et cela lui change littéralement la vie (puisque l’IA lui indique qui est qui). Puis elle finit par s’en éprendre car Holo est attentionnée et se comporte comme un véritable ami.
Le Grand Méchant, forcément, veut voler cette technologie.
Et on obtient une sympathique série de SF parce que le tout est agréablement équilibré :
la SF, le rapport à la technologie : comment elle peut nous épauler, mais également comment elle peut nous accaparer (Holo, lancée sur le marché, se révèle très addictive pour les utilisateurs) ;
l’amitié et l’amour, IA et humains : Elle est-elle amoureuse d’Holo ou de son créateur qui l’a conçue à son image ? Les sentiments de l’IA sont-ils réels ?
le mystère : pourquoi la mère de Lui est-elle morte ? qui veut voler l’IA ?
Bref, rien à dire de plus sinon : faites vous plaisir, regardez 😉
Ce billet est également paru dans la Tribune des Vagabonds du Rêve.
Tempted (The Great Seducer)
 Je vais commencer par un préambule : je veux des happy ends. OK, il y a tout un tas de bons arguments pour démontrer qu’une happy end n’est pas indispensable, mais, perso, je n’ai pas envie de me farcir seize heures (longueur moyenne d’un drama) avec des persos pour que, à la fin, ils meurent écrasés par un tractopelle. Notez qu’en plus je ne suis pas difficile : je prends les fins ouvertes (difficile, vu mes propres histoires, de les renier) et mourir en sauvant la galaxie est une happy end. Juste, voilà, ne me faites pas vivre des heures auprès de gens pour les massacrer à la fin.
Je vais commencer par un préambule : je veux des happy ends. OK, il y a tout un tas de bons arguments pour démontrer qu’une happy end n’est pas indispensable, mais, perso, je n’ai pas envie de me farcir seize heures (longueur moyenne d’un drama) avec des persos pour que, à la fin, ils meurent écrasés par un tractopelle. Notez qu’en plus je ne suis pas difficile : je prends les fins ouvertes (difficile, vu mes propres histoires, de les renier) et mourir en sauvant la galaxie est une happy end. Juste, voilà, ne me faites pas vivre des heures auprès de gens pour les massacrer à la fin.
Tout ça pour dire que, même si Tempted est librement inspiré des Liaisons dangereuses, aucun personnage ne meurt de MST à la fin 😉
Au départ, je n’avais pas prévu de parler de cette série car elle m’a laissée une impression mitigée et puis, au final, en y repensant, l’impression qui me reste, qui domine, est une sorte de tendresse à partager.
Si-hyeon, Su-ji et Se-ju (oui, la similitude des deux noms est visiblement voulue, mais c’est une vraie galère à suivre 😛 ) sont trois amis, trois jeunes adultes fusionnels, cruels et tristes. Leur trio est leur force, face à la vie, aux difficultés, mais les enferme aussi, forcément.
Lorsque Gi-yeong (le seul vrai salopard de l’histoire) éconduit cruellement Su-ji, celle-ci demande à Si-hyeon, pour se venger, de séduire Tae-hee, le grand amour du méchant, pour ensuite la larguer.
Si-hyeon s’exécute, par affection pour son amie, et… forcément, s’éprend de Tae-hee.
Su-ji, qui était en réalité amoureuse de Si-hyeon, va en souffrir ; Se-ju, qui était amoureux de Su-ji…
Bref, rien de trop original a priori.
Le charme prend par la juxtaposition des générations : si les vingt-ans souffrent et sont mal, c’est également parce que la génération de leurs parents souffre et va mal. Les histoires s’entremêlent donc dans une sorte de malaise mélancolique dont personne ne trouve la sortie.
Tae-hee (et son père) représente la sage au milieu des fous. Intelligente, sure d’elle, elle est presque un peu too much au milieu des losers. (A noter que les deux persos sont ceux qui ont vécu « ailleurs » — en Allemagne — comme si cela les avait insensibilisés aux soucis locaux de bien marier son enfant, par exemple.)
Si-hyeon (je dirais que lui est le héros alors que Tae-hee endosse plus le rôle de la quête) est extrêmement touchant, rongé par la culpabilité : que vaut sa relation puisqu’il a abordé celle qu’il aime de mauvaise façon (il a enquêté sur elle pour l’arnaquer) pour de mauvaises raisons ?
Au final, je crois que j’ai été touchée par la façon dont les gens se perdent dans leurs propres nœuds. A un moment, Tae-hee dit quelque chose comme “les secrets n’ont d’importance que pour les gens qui veulent les préserver”, genre tout le monde s’en fout de ce que vous voulez dissimuler.
Une série ni drôle ni gaie, touchante, pas addictive, mais bien jouée/réalisée.
Changement d’année ?
Quand j’étais enfante, nous (ma famille) avons été victimes d’une grand-mère… folle ? méchante ? désaxée ? Pour poser un diagnostic précis, il faudrait qu’elle soit encore en vie et vue par un médecin qualifié. End of story. Résumons cela à : personne n’en aurait voulu comme parente, mais on ne choisit pas ses parents.
Pour nous, si Noël était un moment chaleureux, il était immanquablement suivi du Jour de l’An où une décision de justice (rendue dans des conditions douteuses) imposait à deux enfants de passer ce temps avec une grand-mère dont ils mesuraient tout à fait consciemment l’extrême méchanceté. Je ne souhaite à personne de laisser un tel souvenir de soi à son départ de la Terre.
Un jour, nous prîmes la décision de remettre en cause la décision de justice (du haut de mes dix ans, j’ai ouvert la porte et j’ai dit « casse-toi, tu pues, tu fais pleurer mes parents » — sans doute pas tout à fait, j’ai dû trembler et avoir très peur, mais je suis très fière de ce moment), mais nous n’avions pas eu l’occasion d’apprendre à fêter le nouvel an. Et je crois que ça n’est jamais venu.
Quand j’étais une jeune femme, en couple, je me suis forcée quelques années à vivre un réveillon comme il semblerait qu’il doit être vécu, avec des potes, trop de nourriture, un marqueur social qui valide que, oui, on appartient à un groupe.
Le 31 décembre dont je me souviens le plus facilement, c’est celui que j’ai passé seule à la maternité 😉
(Et de celui où j’avais 17 ans et où les suites des aventures de Raistlin — dont j’étais amoureuse, forcément — étant sorties, j’étais plus impatiente de savoir ce qui lui arrivait que de dîner avec mes parents 😛 )
Bref…
Je ne fête pas le nouvel an. Je ne le fuis pas non plus. J’ai pour principe de ne pas refuser de boire un verre ou de partager un morceau avec un·e pote car, quand on commence à fuir les autres, on se désociabilise très vite. Mais il y a un fossé entre ne pas refuser une invitation et en lancer ou aller en chercher.
Pourtant… alors que c’est complètement artificiel, je vois un intérêt particulier à passer au 1er janvier.
Au fil du temps, les petits soucis et les grosses galères s’accumulent et, parfois même pour les joies, on ne prend pas le temps de se poser et de les assimiler.
Il y a toujours des moments où… l’on se pose devant sa penderie et on décide de jeter tous les vieux vêtements qu’on ne remettra jamais… l’on se pose devant sa bibliothèque et on se dit qu’on peut donner ces livres qu’on n’a jamais ouverts ou qu’on ne rouvrira plus… l’on vire les mille mails non traités qu’on ne pourra pas traiter, de toute façon, la demande est trop ancienne…
Le 1er janvier est l’un de ces moments : les galères deviennent les évènements déplaisants d’une année archivée en N-1, on peut prétexter les vœux pour prendre des nouvelles de celles/ceux qu’on a délaissé·es, on peut croire que tout ira mieux comme les jours de rentrée, enfant, quand on prenait des cahiers neufs et qu’on se promettait que, oui, cette année, on les tiendrait bien.
Si je ne suis pas familière des fêtes, je ne suis pas indifférente aux rites qui nettoient.
Je souhaite donc à toustes celles/ceux pour qui la Saint-Sylvestre est un marqueur social fort d’être ce soir avec vos meilleur·es ami·es et, à nous toustes, je donne rendez-vous demain, avec des ennuis archivés, des cahiers neufs et de bonnes résolutions pour celles/ceux qui doivent chasser regrets ou fantômes.
Bref, je nous souhaite à toustes un bon rituel d’apaisement 🙂
Guardian: The Lonely and Great God (2016)

En commençant à m’intéresser aux séries coréennes, j’ai très rapidement entendu parler de Goblin (l’autre titre de la série — c’est assez fascinant le nombre de titres qu’on trouve pour une même oeuvre) qui raconte l’histoire d’un dokkaebi (et pas du tout d’un gobelin — à quelle époque reculée quelqu’un a-t-il cru bon de traduire l’un par l’autre ???) et j’étais forcément curieuse d’une histoire portant le nom d’une créature mythique. Mais je suis paresseuse et la série n’est pas diffusée sur Netflix. Puis, récemment, j’ai pris un abonnement à Viki et j’ai donc enfin satisfait ma curiosité.
Alors… même si ce n’est pas l’histoire d’un gobelin, on est bien dans de la fantasy :
Il y a environ 900 ans, un Général était si puissant qu’il a fini par devenir un dieu (littéralement) de la guerre pour le peuple, mais le Roi, mariée à sa Sœur et conseillé par le très vilain Méchant, jaloux qu’un simple général puisse passer pour l’équivalent d’un dieu, le tue (et sa sœur aussi, il fait un lot groupé).
A sa mort, le Général est transformé en dokkaebi et la vie ne pourra lui être ôtée que par sa fiancée (i.e. s’il rencontre l’amour).
C’est simple, classique et ça fonctionne.
A notre époque, le Général sauve la vie d’une femme enceinte et de l’enfant qu’elle portait. Ledit enfant, par cette magie, devient sa Fiancée, fiancée qui n’est même pas inscrite dans les registres de la Mort puisqu’elle n’aurait pas dû venir au monde/n’avait même pas de nom.
La Fiancée échappe aux faucheurs, atteint le bel âge de 19 ans, rencontre le Dokkaebi qui vit désormais en coloc avec un faucheur…
Le tout forme un récit très sympa de fantasy, avec des trucs cools, genre le voyage à travers les portes (mais pourquoi parleraient-ils anglais au Québec et alors même que toutes les pancartes sont en français ?), le Dokkaebi qui fait pleuvoir dès qu’il est morose (et pourrit la vie des gens ordinaires), des interventions divines bien gérées…
A vrai dire, je ne peux que vous invitez à voir cette série sympa, mais… certaines choses m’ont pourtant vraiment agacée et font que, même si j’ai bien aimé, ce n’est pas le grand frisson. Sauf que, pour le coup, impossible à expliquer sans SPOILER donc je vous invite à stopper ici votre lecture si vous ne souhaitez pas en savoir plus pour le moment…
[SPOILERS EN APPROCHE]
Un des gros ressorts narratifs de cette histoire est donc la mort et la réincarnation.
On découvre (on devine assez tôt, je dirais) que le Faucheur est la réincarnation du Roi et, comme de bien entendu, il s’éprend de la réincarnation de la Sœur. Quand Roi et Sœur retrouvent leurs souvenirs, cela ne fait que confirmer leur amour, mais également l’impossibilité de le vivre : le pardon a des limites, disons, et le Roi a quand même assassiné sa femme.
Pour ces deux personnages, OK, la seule issue possible est la mort/réincarnation avec l’effacement des vies passées.
Mais ce n’est pas parce que ça marche pour eux que ça marche pour tout le monde !
Le Dokkaebi meurt une première fois quand sa Fiancée a 20 ans, mais, comme il est badass après tout, il erre dans un endroit qui n’est pas répertorié (un truc du genre — c’est idiot, mais ça me fait penser à l’un de mes propres textes, l’Ange sur la traverse, où le personnage est perdu, mais pas vraiment en Enfer) jusqu’à ce que sa Fiancée, dont la mémoire a été effacée, le rappelle quand même (parce qu’ils ont signé un contrat).
Il doit lui redonner ses souvenirs et, franchement, jusque là, j’ai marché.
Sauf que… le lendemain de leur mariage (elle vient d’avoir 29 ans), elle meurt dans un accident de voiture pour sauver plein de gentils petits enfants (et c’est très bien).
Sauf qu’elle refuse de boire le thé de l’oubli (que les faucheurs servent aux morts pour effacer leurs vies passées) et elle peut donc tranquillou se réincarner et retrouver son chéri (alors qu’il devrait y avoir des conséquences si on refuse de boire ce thé, non ???).
Je n’ai absolument rien contre les fins heureuses, hein… mais, par contre, je trouve insupportables les ressorts narratifs qui ne servent à RIEN : si elle n’a pas la mémoire effacée, qu’elle meurt ou pas, quel intérêt ? Genre le seul suspens, c’est si elle va mettre longtemps à se réincarner et, sérieusement, pour un gars qui a vécu plus de 900 ans, attendre 30 ou 40 ans, est-ce vraiment une différence notable ???
La Fiancée réapparaît quand même des années plus tard dans le même costume de lycéenne, hein ! Et elle lui demande s’il la reconnait. Sérieux ?
Bref, il y a vraiment des trucs bien sympas, mais il y a un manque de maîtrise, genre de chouettes idées, mais personne n’a relu ou un truc comme ça.
Ou un auteur qui n’a pas su poser le mot FIN. Parce que, par exemple, c’est très mignon que le Roi et la Sœur puissent s’aimer dans une vie prochaine, mais… on le sait déjà quand on les voit franchir la porte de la Mort main dans la main. On n’a pas réellement besoin de voir leur prochaine vie.
Voilà, très sympa, mais ça a manqué d’un stylo rouge qui coupe de gros morceaux… et, au fond, ça m’agace parce que ça pourrait être vraiment top sinon.
Ce billet est également paru dans la Tribune des Vagabonds du Rêve.